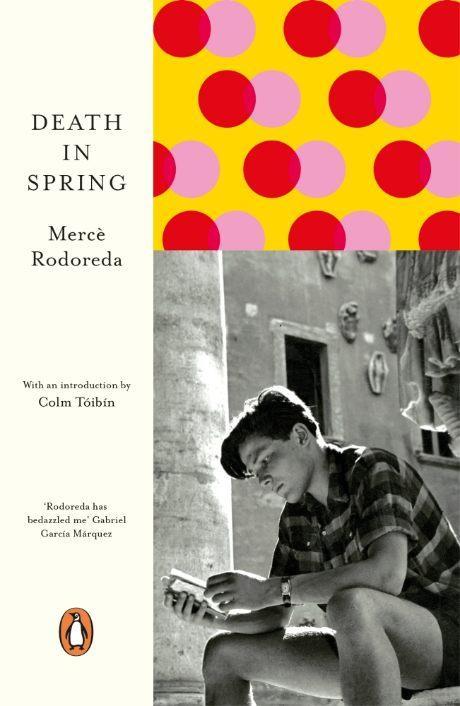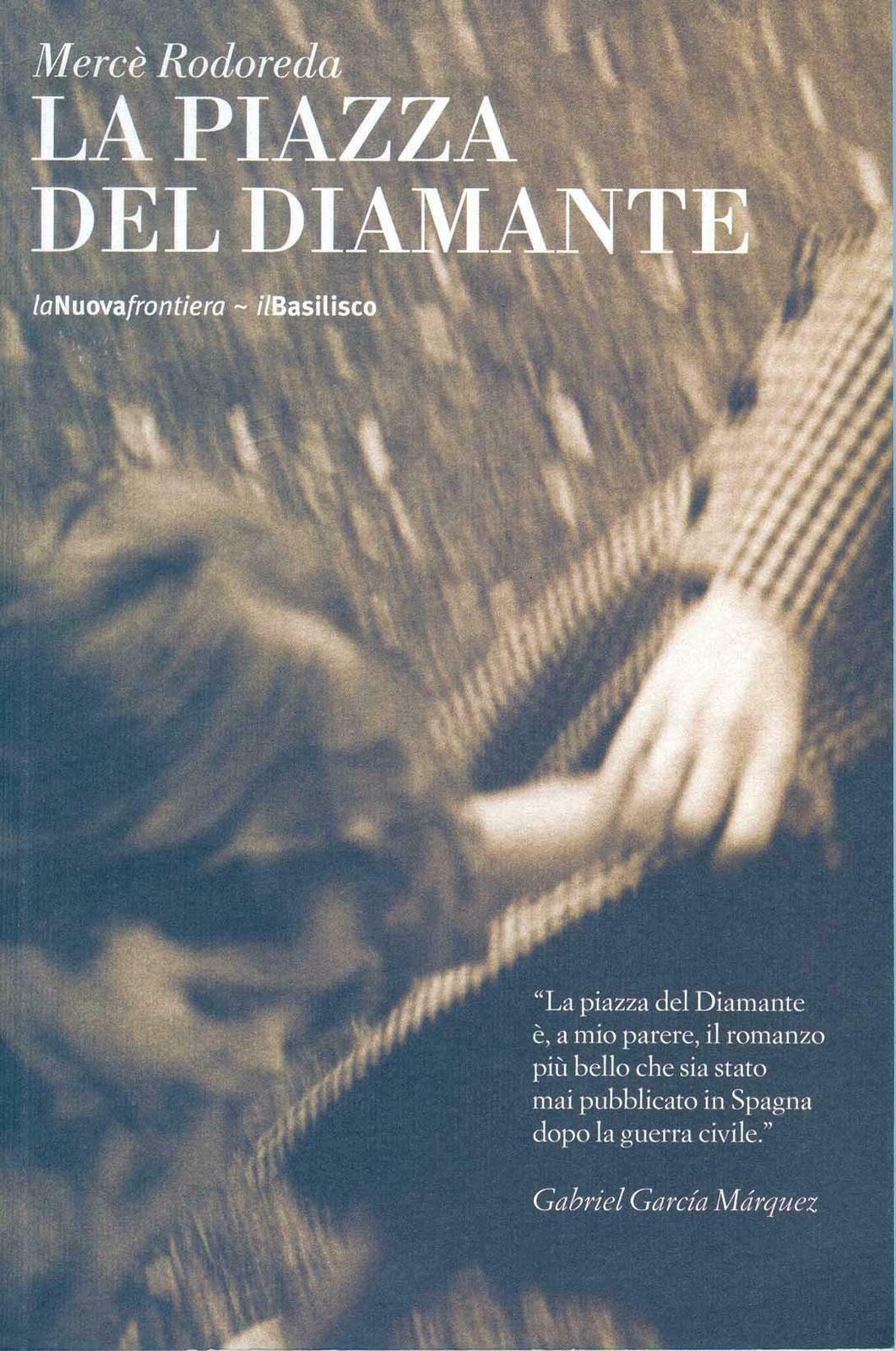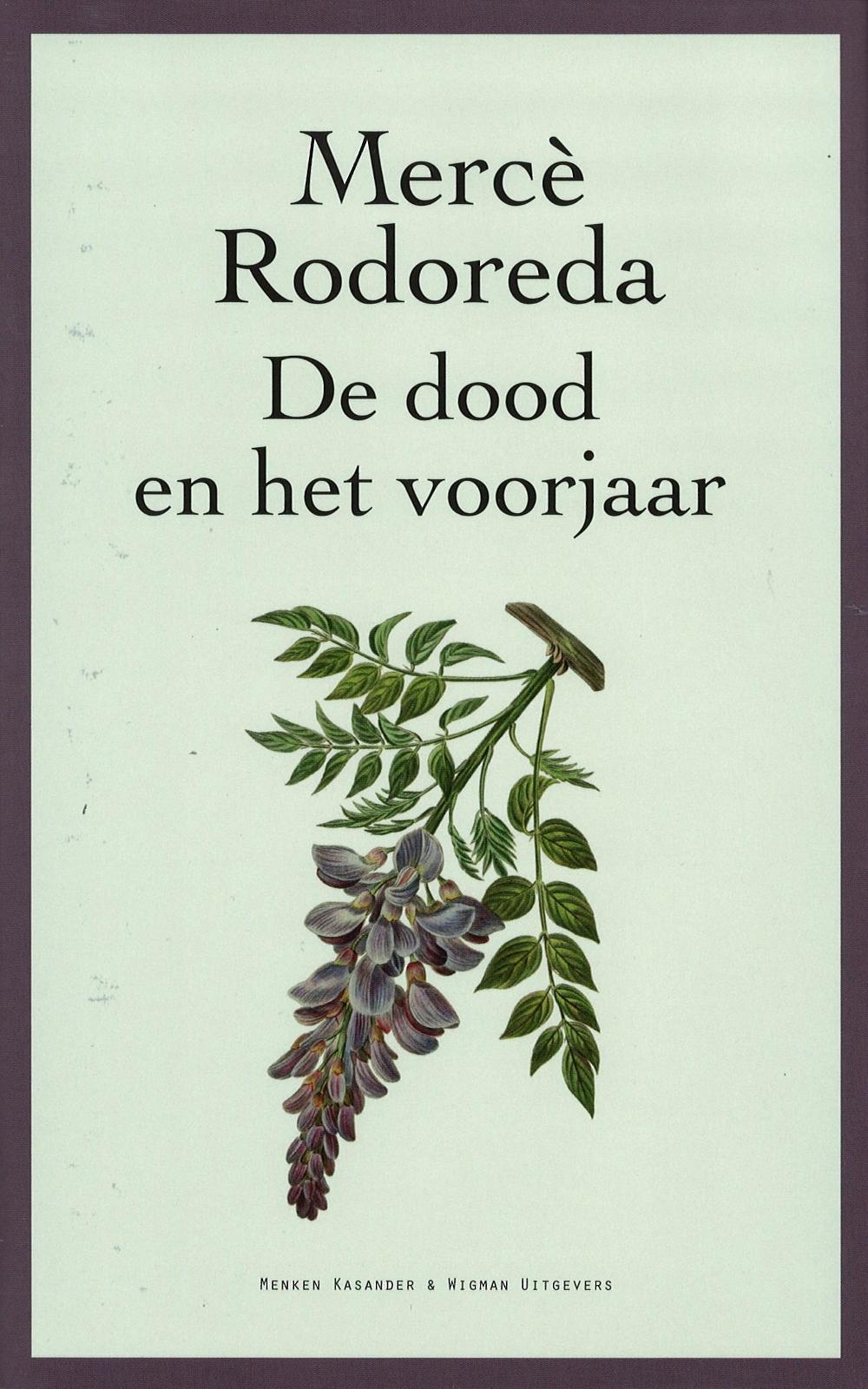Il n’est pas surprenant de voir qu’à chaque nouvelle traduction de Mercè Rodoreda (1908 – 1983), de nouveaux lecteurs en célèbrent la lecture comme une découverte. « Le monde n’est pas créé une fois pour toutes », écrivit Marcel Proust, « mais aussi souvent qu’un nouvel artiste original est survenu : le monde nous apparaît entièrement différent de l’ancien mais parfaitement clair ». Rodoreda fait partie de ces découvertes qui changent le regard du lecteur parce qu’elle le fait pénétrer dans un univers littéraire aussi personnel et sophistiqué que le Paris de Marcel Proust ou le Yoknapatawpha de William Faulkner. Dans le monde de Rodoreda, il n’y a pas d’aristocrates décadents ni de sudistes ruinés. Il y a des Catalans désorientés par un XXe siècle qui les a terrassés et a détruit leur ville, Barcelone, qui est l’épicentre de certains des romans de l’auteure. Si Rodoreda est l’écrivaine catalane la plus importante du siècle dernier, c’est parce que ses histoires se situent dans un univers qui n’existe plus que dans sa mémoire, comme cela est habituel chez les grands écrivains.
Sa vie est l’explication la plus claire de cet univers détruit. Fille d’une famille cultivée et moyennement aisée, Rodoreda vit l’éclosion culturelle de Barcelone avant la guerre civile. Elle travaille comme journaliste, elle écrit de la poésie, du théâtre, des contes et des romans ; elle aspire à gagner sa vie en écrivant, en profitant de l’énorme liberté dont elle dispose. « Sous la République – explique-t-elle – nous menions une véritable vie catalane, très brillante. Les gens entraient tout de suite en contact, se sentaient importants. Et ils sentaient qu’ils étaient dans une ville importante. Disons que Barcelone était le centre intellectuel et le centre progressiste, où l’on faisait des choses. C’était un endroit intéressant. Et c’était une Barcelone catalane, je ne sais pas ce que seraient devenus tous ces écrivains si les choses s’étaient passées autrement. » À l’instar des autres écrivains de sa génération, la Guerre Civile détruit ses aspirations et projets.
Prenant l’exil dans un bibliobus de la Generalitat, Rodoreda laisse en Catalogne un mari, épousé par convenance, et un petit garçon et s’installe en France. Après un séjour à Roissy-en-Brie, refuge d’écrivains, elle doit quitter Paris à pied quand les nazis prennent la ville. Elle vit ensuite à Limoges, Bordeaux, puis de nouveau Paris, et s’installe finalement à Genève où elle demeure de 1954 à 1972. Elle vit cet exil avec l’écrivain et critique Armand Obiols, avec qui elle entretient une relation amoureuse tortueuse et compliquée. Obiols est une figure centrale de sa vie et de sa littérature, qu’il suivit de près en la conseillant et l’orientant jusqu’à sa mort en 1971. L’écrivaine catalane la plus importante du XXe siècle passe donc les 30 ans les plus productifs de sa vie littéraire hors de Catalogne. En 1972, elle revient s’y installer dans une maison isolée à Romanyà de la Selva, loin de Barcelone et du cercle littéraire. La solitude et l’isolement marquent la fin de la vie de l’écrivaine, qui fera un effort énorme pour décrire les intimités de l’ambiance sociale et culturelle de son époque, avec des romans dont le point de départ est ce monde mais qui ne tombent pas dans le costumbrismo car, comme elle-même le dit, « je ne suis pas née pour me limiter à parler de faits concrets. »
Le premier des grands personnages féminins que Rodoreda met en scène est Aloma. C’est aussi le titre du premier roman qu’elle reconnaît. Isolée dans un monde intérieur qui la dépasse et qu’elle n’arrive pas à comprendre, Aloma est une adolescente qui verra comment les autres utilisent et manipulent un désir qu’elle pressent mais qu’elle ne parvient pas encore à connaître ni à maîtriser – une lutte que livreront un grand nombre des héroïnes de Rodoreda. C’est la première d’une saga de femmes qui se rendent compte qu’il existe un écart énorme entre ce qu’elles désirent réellement et ce que l’on attend d’elles. Aloma est un monologue intérieur dans lequel Rodoreda trace une voie qui se sophistiquera et se compliquera progressivement jusqu’à son dernier roman : la capacité à creuser dans la psychologie des personnages pour essayer de comprendre les va-et-vient du cœur. Cette exploration de la subjectivité brillera tout particulièrement dans ses contes, proches de ceux de romancières comme Woolf ou Mansfield, que Rodoreda lisait et admirait.
Les années soixante sont un âge d’or pour l’écriture de l’auteure, qui trouve enfin la stabilité économique qui lui manquait depuis la guerre et lui fit mener une vie très précaire, une vie de subsistance seulement. C’est dans cette décennie que paraît La place du diamant, le roman qui place Rodoreda à la tête de la littérature catalane et qui, avec Gloire incertaine de Joan Sales, est encore aujourd’hui l’œuvre le plus importante sur la Guerre Civile en Catalogne et ses conséquences. L’héroïne de ce roman est une jeune fille à qui l’on a tout pris, même son nom. C’est une femme qui se consume sous les pressions d’un milieu qui l’asphyxie jusqu’à la pousser à une tentative de suicide. C’est un roman impitoyable et cru, qui explique comment la guerre détruit un individu, une ville et un pays. Après en avoir lu le manuscrit, Obiols écrivit : « J’ai eu la gorge nouée trois ou quatre fois, certaines pages sont d’une vérité troublante. Très peu de gens ont dû savoir parvenir à cet équilibre parfait entre le dramatisme, la poésie et la banalité. Et je te le dis non pas après avoir lu un roman policier mais juste après avoir achevé – immédiatement après – Les possédés de Dostoïevski. »
Après la Colometa de La place du diamant, Rodoreda durcit l’univers qu’elle construisait pour créer Cecília Ce, l’héroïne de Rue des Camélias, un des meilleurs romans jamais écrits sur Barcelone. La citation de T.S. Eliot au début du livre n’est pas fruit du hasard : « I have walked many years in this city ». Cette citation relie l’héroïne à ses errances dans Barcelone qui expliquent son envie d’échapper à ce qui l’entoure et à elle-même. Cecília Ce est une enfant trouvée. Jeune fille, elle quitte la maison familiale et commence à déambuler dans la ville, « légèrement pathétique, légèrement désolée », comme une flâneuse baudelairienne. Cecília vit toujours en marge de la société, que ce soit dans les masures de Somorrostro ou en se prostituant dans un appartement de l’Eixample. Rodoreda écrit ce roman à Genève, à partir du souvenir d’une ville qui n’est plus la sienne : « Quand j’y suis revenue la première fois après la guerre, en 1948 – écrit-elle – l’aspect de Barcelone était déprimant, sinistre. Les gens marchaient dans les rues l’air triste et soumis. » Rue des Camélias est un roman destructeur, où nous pressentons un monde obscur et onirique qui ne cessera de grandir dans ses livres. La romancière a le souvenir de la ville d’avant la guerre, l’image de splendeur et de gaieté que l’on respirait dans les rues. La violence de ce contraste lui sert à décrire dans l’exil une Barcelone qu’elle ne reconnaît plus comme la sienne.
Un an plus tard, elle publie Jardí vora el mar, un roman dans lequel elle s’essaie à deux sujets qui éclateront ensuite dans toute leur splendeur dans Miroir brisé : les ravages du temps sur l’amour et la décadence d’une famille sur plusieurs générations. Dans ce livre, Rodoreda met en scène un type de personnages qu’elle se complaît à recréer : les riches qui ne pensent qu’aux choses matérielles, à la manière des personnages de Fitzgerald, et qui plus ils en possèdent, plus ils sont vides. Dans le livre, un jardinier explique, d’après ce qu’il a vu et entendu, l’histoire de la famille qui passe l’été dans sa maison au bord de la mer six étés durant. C’est un roman fait d’insinuations, qui consolide le style de Rodoreda basé sur des choses secrètes que l’on devine mais que personne n’explique jamais complètement, qui préparent le lecteur à construire dans sa tête tout ce que l’on pressent dans l’histoire. Jardí vora el mar commence plein d’espoir et finit en tragédie, une structure qui se répètera, avec bien plus de force, dans son avant-dernier roman achevé, Miroir brisé.
Ce roman raconte l’histoire d’une maison et de la famille qui y vit. Rodoreda veut expliquer l’essor et la chute d’une saga familiale tout en montrant l’essor et la chute d’une ville, d’une société et d’un pays. Rodoreda aimait les livres tournant autour d’histoires familiales compliquées, comme les Sartoris de William Faulkner qui racontent les vies de jeunes filles qui grandissent comme des fleurs sauvages dans les grandes maisons coloniales dans le sud des États-Unis. La romancière ne choisit pas la maison de riches planteurs de coton sudistes mais une villa du quartier huppé de Sant Gervasi. Mais son intention est bien la même que celle de Faulkner : expliquer la chute d’une famille à partir de l’endroit où elle vit. Miroir brisé recueille à partir des trois héroïnes du roman tout l’éventail de féminité que Rodoreda voudra expliquer dans ses livres : une femme magnétique et bienveillante, une autre frustrée et au cœur sec, et la dernière, vitaliste et idéaliste qui finit par ne plus pouvoir supporter tout le poids de ce que la vie lui fait subir. C’est la plus haute expression du cycle réaliste de l’écrivaine, écrit à partir des morceaux de ce miroir qui composent ensemble une voix commune fragmentée.
Dans ses deux derniers romans, Tant et tant de guerre et La mort et le printemps – ce dernier inachevé –, Rodoreda explore un monde qu’elle avait tenté de dessiner au cours de toute sa carrière littéraire. Dans le premier, Rodoreda voulait, comme elle le disait elle-même, « un roman contenant peu de guerre mais avec un fond permanent de guerre. » Et elle le fait à partir d’un anti-héros, un adolescent qui fugue, mû par l’aspiration à une liberté qui ne le mène qu’à une autre sorte de prison. C’est un livre sur la guerre, la peur, l’amour, le nihilisme ; un livre qui s’inscrit pleinement dans la tradition européenne des romans sur la manière dont la guerre modifie la réalité et le langage. La mort i le printemps – édité en 2018 en anglais chez Penguin – va dans le même sens ; le roman commence par une citation chargée de sens : « le mystère de ce poids que j’ai à l’intérieur, qui ne me laisse pas respirer. » C’est justement la sensation qu’a le lecteur quand il le lit, quand il ressent que le livre a été écrit par quelqu’un qui a fait de grands efforts pour sortir respirer alors qu’on l’étouffait. La mort et le printemps est la face la plus étrange et monstrueuse de l’univers de Rodoreda. L’histoire se déroule dans un village indéterminé, à une époque indéfinie, où les habitants vivent dans un système oppresseur qui les transforme en morts vivants. Ce sont des hommes qui, bien qu’ayant peur du noir, préfèrent la nuit au jour parce que « avec la lumière du jour, on voit trop les choses, et il y en a de trop laides. » Le but du système est de répandre la peur et d’éliminer le désir, ce désir qui est présent dans tous les ouvrages de Rodoreda et qui lutte contre un monde qui ne l’accepte pas pour pouvoir enfin jaillir.
Armand Obiols écrivit que ce qui l’impressionnait le plus de La place du Diamant, c’était « une sorte de vide intérieur, une sorte de puits hallucinant, [...] c’est le vide final de toute vie humaine, comme le vide d’une guerre, une sorte de vide métaphysique, qui est le vide du néant qu’il y a derrière toutes les sensations, passions et sentiments. » C’est dans La mort et le printemps que ce vide devient plus présent parce que Rodoreda ne l’insinue pas, elle en fait le sujet central. Ce livre est une vengeance face au silence et la peur. Une des leçons du roman est que, quand tout le monde se tait, la peur est contagieuse, comme cela arrive aux habitants du village, qui vivent sous une menace sans savoir si elle est réelle : « Si tu vis en pensant que la rivière engloutira le village, tu ne penseras plus qu’à ça. », dit un personnage du roman.
Rodoreda dit une fois qu’il y avait une circulation intense de sang et de morts autour des gens de son époque ; il s’agit là du noyau de ce roman, ce sont les éléments qui paralysent et font éclater le cerveau de tous les habitants du village. Il est inévitable de penser que Rodoreda écrivit ce livre terrible et dur pour tenter d’expliquer tout le sang et les morts que cache la peur. Comme dit un personnage, pour Rodoreda « il n’y avait pas de mots, il fallait les créer. ». Et la romancière consacra sa vie à créer ces mots, à construire de presque rien un univers qui tentait d’expliquer son monde disparu. « Un roman, c’est aussi un acte magique – écrit-elle. Il reflète ce que l’auteur a en son intérieur sans qu’il sache qu’il porte une telle charge. » Au fil du temps, Rodoreda apprit à cohabiter avec la charge qu’elle portait, qui n’était autre que ce qui avait transformé son pays en un lieu irrespirable. L'écrivaine souffrait parce que cette charge pesait comme un mort et elle trouva que la seule manière de l’alléger était de venger le sang et les morts avec ses mots nouveaux.
« L’essentiel dans l’écriture – dit Rodoreda –, c’est de trouver le moyen d’expression, le style. » Elle, elle le trouva et s’y livra avec ambition, talent et beaucoup d’effort. C’était une écrivaine entièrement vouée à son œuvre – c’est ce que nous lisons dans sa correspondance – et elle réussit à la bâtir jusqu’à créer un cycle de romans inédit jusqu’alors dans son pays. « En Catalogne – dit-elle – le roman cache des choses et n’a pas de sens. Nuançons un peu : il cache beaucoup de choses et a très peu de sens. ». Je dirais qu’avec son œuvre, l’intention de l’écrivaine, qui connaissait très bien sa tradition et savait la mettre en rapport avec l’universelle, était de redonner un sens à son monde. Elle le fit avec un langage qui, comme celui des artistes originaux, crée une fois encore un monde – entièrement différent de l’ancien mais parfaitement clair. Proust écrivit que « quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses », nous avons besoin d’un élément qui fasse naître « l’édifice immense du souvenir ». C’est ce que fit Rodoreda avec sa mémoire : elle la recréa dans ses livres et chaque génération de lecteurs la fera renaître en la découvrant.