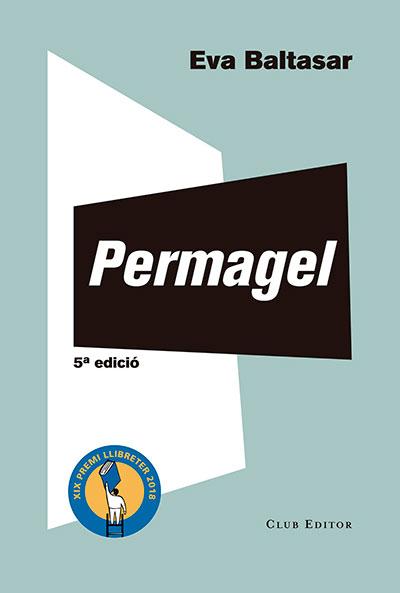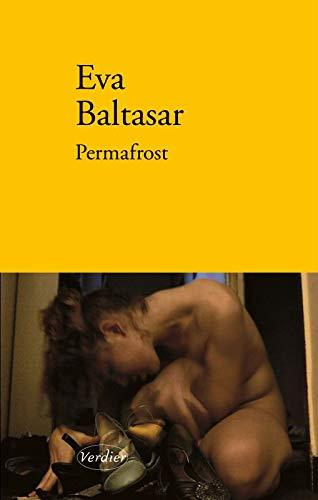Eva Baltasar (Barcelone, 1978) a débuté en 2008 avec Laia, un recueil de poèmes qui a reçu le prix Miquel de Palol. Depuis, elle a publié neuf autres ouvrages de poésie – tous primés – et son premier roman, Permafrost, qui a connu un énorme succès grâce au bouche-à-oreille et qui suppose la première partie d’un triptyque dans lequel la romancière explore à la première personne la voix de trois femmes différentes. Avec acidité, ironie et goût du langage exact et vibrant, le roman parle sans ambages des relations familiales, du lesbianisme, du suicide ou de la masturbation infantile, des sujets qui ont fait du livre toute une référence pour son aspect provocateur, sincère et ouvert.
Jusqu’à présent, vous étiez connue comme poète, avec un long parcours jalonné de prix.
Je vis assez en marge de tous les circuits littéraires. Un beau jour, il m’a semblé que le premier recueil de poèmes que j’avais écrit, Laia, dédié à celle qui est devenue mon épouse, était assez bon et que j’aimerais en faire quelque chose. Comme je ne savais pas du tout comment ça marchait – je n’avais même pas pensé à l’envoyer à un éditeur –, je me suis présentée aux prix de la Fondation Prudenci Bertrana – nous vivions à Girona à l’époque, c’était le plus près et le plus pratique – qui avaient une catégorie de poésie. Et vlan! Le recueil a gagné. J’ai pensé que c’était une bonne manière de publier, avec l’avantage que les prix ont une dotation économique qui fait toujours plaisir (elle rit). Et c’est ainsi que tout a commencé : j’avais un recueil de poème, je le présentais à un prix et il le remportait.
Et vous les avez tous publiés ainsi. C’est une bonne manière de faire les choses, sans avoir à rentrer dans le circuit.
Pour moi, c’était le plus pratique parce que je ne suis pas un rapsode non plus, je n’aime pas réciter. D’ailleurs, c’est aussi ce que j’ai fait avec Permafrost. Quand je l’ai eu fini, je l’ai présenté à un prix, un de très important. Si on rêve, on rêve grand : je l’ai présenté au prix Sant Joan, manière de voir ce qui se passait. Et c’est Carme Riera qui l’a remporté mais moi j’ai été finaliste, ce qui a été décisif pour me permettre de penser que le roman était bon. J’ai alors décidé de ne plus le présenter à des prix et de l’envoyer à un éditeur. Et j’ai choisi Club Editor pour son catalogue.
…Et au premier coup, on vous l’a accepté.
Oui ! Maria Bohigas m’a répondu au bout de vingt minutes. J’adorais le catalogue mais je ne savais même pas qui se trouvait derrière Club Editor. J’ai envoyé le livre à l’adresse générale qui apparaît sur le site. Maria devait être dans les bureaux, connectée à ce moment-là. Elle a lu la première page, je lui ai expliqué que c’était un triptyque, ça lui a plu et elle m’a proposé d’entreprendre le chemin ensemble.
Un chemin qui aura une continuité.
J’avais fini Permafrost et j’avais éprouvé un tel plaisir à l’écrire que j’ai pensé que j’en ferai deux autres. J’ai tout de suite commencé Boulder. Mais alors que je l’avais presque achevé, je l’ai relu et je me suis dit que je préférais Permafrost. Et il ne pouvait pas être ainsi ! Le deuxième roman doit vous plaire au moins autant que le premier, encore plus si possible. Je l’ai donc effacé de mon ordinateur…
Entier ?
Je n’en ai gardé qu’une phrase que j’aimais beaucoup. Et pour changer d’air, je me suis dit que je commencerai Mamut, qui devait être la troisième partie. Ce sont des femmes différentes dans chaque livre, avec leur propre voix. Ce sont des romans qui se complètent au niveau des sujets traités. J’avais achevé Permafrost et je pensais que j’adorerais parler de ce que représente la vie de couple, ou la maternité, que ce serait un des sujets de Boulder et Mamut. Mais Mamut est un roman plus rural.
En fait, dans Permafrost, il n’y a pas de paysage.
L’Écosse apparaît ponctuellement mais elle n’a pas de poids spécifique. Dans Mamut en revanche, le paysage est essentiel, l’histoire se déroule dans une Catalogne rurale, mon milieu quotidien actuellement.
Ce ne sont pas des livres autobiographiques, comme vous le dites souvent, mais votre vie se greffe sur chaque roman, d’une manière ou d’une autre.
Bien sûr qu’elle s’y greffe ! Je récupère des paysages que j’ai vécus. Et la voix… Ce que mes héroïnes disent et expriment, je le défends. Pas tout évidemment, mais une partie importante. Boulder est une histoire dont j’aime beaucoup l’héroïne maintenant. J’ai la chance d’avoir Maria Bohigas derrière moi, mais sans pression.
Comment ça se passe le travail avec elle ? Elle est très participative ?
Nous travaillons le texte ensemble avant sa parution. Elle le lit et elle suggère mais on peut en discuter. En fait, Maria Bohigas vous séduit même quand elle fait des suggestions, vous pensez tout de suite « Oui, Maria, je te comprends parfaitement » (elle rit). Elle aime réduire, ça oui… avec Permafrost nous l’avons fait d’ailleurs.
Aujourd’hui encore, Permafrost continue à bien se vendre. C’est un longseller. D’où vient le succès de ce livre à votre avis ? De l’héroïne, qui sait accrocher le public ? Peut-être des tabous que le libre rompt ?
Je suis allée à de nombreux clubs de lecture et ce que je peux vous dire, c’est ce que me disent les lecteurs. D’une part, c’est un livre qui a trouvé un public de tous les âges. D’autre part, j’ai rencontré des gens qui me disent que l’histoire n’était pas importante pour eux mais qu’ils ont beaucoup aimé la manière dont le roman était écrit. D’autres m’ont dit qu’ils se sont sentis identifiés avec les personnages ou avec certaines phrases de l’héroïne. Des gens qui voient écrit ce qu’ils pensaient et ne savaient pas comment le dire.
La poésie permet d’avoir un espace très intime, de recueillement. En revanche, dans Permafrost vous êtes très en contact avec les lecteurs, vous assistez à des salons, des événements, des présentations et des clubs de lecture. Comment le vivez-vous, vous qui avez toujours tant apprécié la solitude ?
C’est vrai que je voyage beaucoup maintenant mais je le fais seule. Quand j’ai un acte, je suis seule la plupart du temps, je peux me promener ou rester à l’hôtel. Après, quand je suis chez moi, je suis entièrement chez moi : je me consacre à ma fille, qui a 8 ans. Je vais la chercher à l’école, nous mangeons ensemble à midi, j’oublie tout le reste. Par contre, j’aime beaucoup les clubs de lecture. Vous rencontrez les lecteurs, ils sont contents, vous parlez avec eux et ils vous apprennent des choses que vous ne saviez pas. J’en ai fait une cinquantaine. Au départ, je vous avoue que j’étais très réticente parce que cela signifiait sortir de ma zone de confort. Mais j’ai décidé que le livre l’exigeait, que les lecteurs l’avaient fait grandir et que je devais être généreuse moi aussi, me laisser aller. Quand vous prenez cette décision, tout devient plus facile. Cela m’a permis de connaître des gens mais aussi de m’enrichir en tant qu’écrivaine.
« À la poésie, qui permet tout » c’est la dédicace au début du livre. Comment avez-vous vécu le passage de la poésie au roman ?
Je ne le vois pas comme un passage. J’ai commencé à écrire le roman par hasard. Je vivais heureuse en écrivant de la poésie. Mais, un beau jour, je suis allée voir une psychologue et, au cours de la première séance, elle m’a demandé de lui écrire ma biographie sur quatre pages. J’ai alors réalisé que je commençais à broder, que j’avais découvert la voix d’une femme qui expliquait ma vie mais avec de petits mensonges pour la rendre plus intéressante. Je me suis rendu compte que ça n’avait pas de sens pour la thérapie mais cette voix m’a séduite et j’ai continué à écrire. C’est ainsi que Permagel a vu le jour. Je ne le vois donc pas comme un passage : j’ai fait un schéma de la trame et ensuite, comme en poésie, je me suis mise à travailler le langage et les mots. Et c’est ce que j’ai aimé le plus : retoucher le texte, trouver le mot exact, réduire un chapitre de dix pages à trois, juste les nécessaires.

« Quel sens ça a, de préparer le corps à la mort quelques secondes avant qu’elle ne survienne ? La mort prend le corps comme l’amour le fait. Qu’elle le prenne donc au dépourvu. » C’est la fin du premier chapitre, comme un avertissement de ce qui adviendra.
Je dois vous dire que je ne savais pas où cela me mènerait, quelle serait la fin. Tout était dans ma tête, très clair, mais pas du tout prémédité. Je ne savais pas comment cela finirait mais je savais qu’il y aurait une mort. Mais laquelle?
Plus tard, la narratrice : « Heureuse ! Ce mot sentait déjà le moisi le jour où je suis née. »
Ça, c’est de moi ! (elle rit) Le bonheur est devenu un produit. On l’a médiatisé, on veut vous le vendre. Mais le bonheur n’a rien à voir avec les échanges ou le commerce.
« C’est un effort suprême qui m’a épuisée. Vraiment, être comme ça, ça vous oblige à prendre des médicaments. » Dans ce monde et dans ce présent, ne pas tomber dans les médicaments est une lutte contre soi-même. Des médecins aux publicités, tous avec des ordonnances pour le bonheur.
J’entoure l’héroïne de personnages qui prennent des médicaments. Sa mère et sa sœur le font pour être heureuse, comme vous dites. C’est un piège qu’elles se posent elles-mêmes. Mais elle, elle refuse de prendre des médicaments, même si elle y pense. Elle veut vivre la vie intensément et lucidement, même si cela la fait souffrir, même si cela la fait penser au suicide. Et c’est pour ça qu’elle profite de la vie, elle est intacte, pas les autres.
« Elle s’est donc mariée avec lui sans se rendre compte qu’elle avait fait quelque chose de bien pire, quelque chose de très littéraire, faire de sa vie un grand mensonge ». Quelle part de vérité ou de construction y a-t-il dans tout ce que nous expliquons ?
Nous avons la vie que nous vivons, celle que nous appelons réelle mais je ne sais pas à quel point elle est réelle. Et ensuite nous avons la vie imaginée, et chez moi les deux se mélangent. Parfois, je me souviens de certaines choses que j’ai expliquées mais que je n’ai pas vécues… et ma femme me dit qu’elles ne sont pas arrivées. Je confonds beaucoup la réalité et mes propres fictions ! J’en ai même des souvenirs très vivants. C’est ma vie inventée (elle rit). Les gens pensent que les choses les plus tragiques du livre ce sont celles qui me sont arrivées. Et non, parfois ce sont les choses les plus petites, les plus triviales. Ici, au village, on me demandait si ma mère avait lu le roman et ce qu’elle en pensait !
Il y a le sujet du suicide, très récurrent au fil du roman.
Ce sont les moments où la vie devient vraiment insupportable. Pour moi, c’est comme des fabulations mais certains lecteurs le prennent au pied de la lettre et souffrent jusqu’au dernier instant. La narratrice fabule et elle le fait avec une forte composante esthétique. Il y a une inquiétude pour sa souffrance et pour ceux qui souffriront ensuite.
Il y a de l’humour, de l’ironie, une touche de grotesque même, comme au chapitre 14, quand elle tente de se taillader le poignet mais : « Merde de Gillette : il y a un capuchon transparent ».
Elle emploie l’ironie et l’humour comme outil pour survivre. Je fais pareil moi aussi, j’ai une vision pessimiste de la société, c’est pour cela que je fais appel à l’humour. Et la voix de Permafrost a tout de suite pris ce ton.
Dans un passage, vous définissez les trois types de mensonge : « Il y a les mensonges accommodants, les évasifs et les pesants ». L’analyse est brillante et révélatrice.
J’ai eu une illumination ! Quand j’écrivais cela, je pensais que c’était vrai. Au fil de ma vie, j’ai beaucoup menti, même si j’essaie de le faire de moins en moins. Et j’ai menti pour passer inaperçue, pour que l’on ne me remarque pas et qu’on me fiche la paix. Mais plus maintenant : je suis comme je suis, et si cela ne vous plaît pas, tant pis.
La sœur demande à plusieurs reprises dans le livre comment c’est le sexe entre femmes. À un moment donné, elle le compare à La grande évasion : « Ce que je voulais te dire, c’est qu’être avec une femme, c’est comme passer ta tête à l’extérieur et découvrir que tu as vraiment creusé les six mètres qu’il restait. »
Écoutez, ces chapitres sont très autobiographiques. C’est quelque chose que j’ai souvent vu dans ma vie. J’ai une formation de pédagogue et je travaille dans un domaine où il y a beaucoup de femmes. Une fois, enfermée dans un bureau, on m’a demandé : « C’est comment, baiser avec une femme ? ». Je suis vraiment restée stupéfaite. Et ça m’est arrivé deux autres fois. La dernière fois, j’ai répondu « On n’a qu’à essayer ! » (elle rit). Ici, j’ai voulu faire ressortir le sujet parce des gens m’ont posé la question sans aucune pudeur. C’est une de ces occasions où la réalité dépasse la fiction ! Pour ce qui est de la référence à La grande évasion, la comparaison m’est tout de suite venue à l’idée. En tant que poète, je cherche toujours l’image.
Le sujet de la masturbation infantile est très explicite. Là vous rompez vraiment un tabou.
Peut-être, oui. Quand je l’ai écrit, je ne savais pas que le livre serait publié. C’est pour cela que j’ai décidé d’écrire comme ça venait, comme je voulais. Pour moi, ce n’est pas un sujet tabou, peut-être parce que j’ai peu sociabilisé. Dans le livre, le sexe a un poids important et je me suis dit : « Pourquoi commencer à vingt ans ? Moi j’ai commencé à huit ans ! ». Et encore, j’ai été prudente parce qu’elle, elle commence à 12 ans… et certains me disent que c’est très tôt !
Jusqu’à la phrase de la fin – et quelle fin ! : « C’est la vie, la sauvage qui nous cherche et nous accule ».
J’ai vraiment eu du mal. Là, Maria Bohigas m’a dit de bien la fignoler. J’ai passé deux semaines à chercher et chercher, comme un chien. Et la phrase est venue, c’était clair. La fin devait être jolie et j’en suis très satisfaite.

interview: Esteve Plantada @eplantada